
Nancy-Saïgon
Adrien Genoudet
Éditions du Seuil, Coll. Cadre rouge
304 pages
22/08/2025
21 €
❝Au bout d’un mois de lettres, j’avais pris le pas de Simone. Comme elle, je lisais à distance, derrière la mer, séparé des gestes de Sanzach. Comme elle, je tentais d’y voir quelque chose, d’apercevoir à travers les mots, sous les phrases parfois bancales et les courriers écrits à la va-vite, les détails qui me permettraient de me figurer les lieux. […] Je cherchais à m’approcher comme le font les historiens. À prendre les mots pour des mimes. […] J’étais persuadé que tout se jouait entre les lignes. […] il m’arrivait de déchirer [les lettres] non sans scrupule. Sans raison si ce n’est celle de me sentir le dernier destinataire, l’ultime lecteur, celui qui lisait tout cela par effraction tout en sachant, quelque part, que plus personne ne lirait ces échanges. Et je prenais conscience de l’effacement des cales des navires, du temps des allers et retours, des longs jours qui séparaient chaque lettre. Je passais d’un courrier à l’autre […] en oubliant qu’entre les lignes gisaient surtout une attente mortifère, un va-et-vient de temps morts. Un océan. […] chaque lettre, chaque mot, chaque phrase avait pris la mer.❞
En ouvrant le dernier roman d’Adrien Genoudet, les lecteurs de Champ des cris (Seuil, 2022) s’avanceront en terrain connu. Ils y retrouveront certains échos (le nom de Sanzach en est un), ainsi qu’un semblable dispositif narratif, car Nancy-Saïgon est lui aussi une mosaïque de formes :
❧ des fragments de lettres où hésitent les points de suspension ;
❧ des conversations téléphoniques dont les nombreux cadratrins miment la respiration ;
❧ une narration à la première personne, celle du narrateur, intime et singulière ;
❧ une autre à la troisième personne, anonyme, pour raconter en surplomb ce que nul ne peut savoir ;
❧ des comptes-rendus, succincts états-civils résumant des vies fauchées là-bas, au-delà des océans qui ❝toujours [...] finissent par engloutir quelque chose❞ ;
❧ une poignée de photographies au petit format noir et blanc issues des archives de l’auteur, l’absence de légende et l’épaisseur du grain entretenant le mystère au lieu de l’éclaircir.
Je soupçonne un tel procédé d’avoir été pensé pour explorer toutes les manières de fabriquer une histoire, de l’inscrire sur la page en imposant un rythme de lecture, de la dire en en décomposant/recomposant le déroulé, zones d’ombre y comprises. Car c‘est aussi dans ce qu’il laisse en suspens que ce roman est une réussite.
2020. Le narrateur est confiné dans son appartement de l’avenue d’Italie noyée de pluie. Il a reçu de la part d’Édithe (sic), la fille de Simone et Paul Sanzach aujourd’hui âgée de soixante-et-onze ans, un carton marqué d‘un sommaire Nancy-Saïgon après que Simone a été exhumée pour être incinérée et ainsi faire de la place dans le caveau de famille. On l’a trouvée vêtue d’un áo dài étonnamment bien conservé. Cet habit traditionnel, tout de crêpe de soie bleu brodé de motifs floraux, lui avait été envoyé par Paul juste avant de disparaître à tout jamais dans la jungle indochinoise où il menait une ❝mission [qui] se résumait à cela, et à vrai dire, une grande partie de la guerre se résumait à cela : tenir pour rien, en improvisant, au beau milieu de nulle part.❞
Le somptueux áo dài et le carton contenant les lettres que Simone et Paul ont échangées pendant de longs mois, alors qu’elle était à Nancy et lui stationné en Indochine, sont les pièces à partir desquelles le narrateur va tenter de recomposer le passé, lui donner une cohérence en se saisissant de ce qui se dévoile, en ressuscitant ce qui se refuse et s’échappe en y adjoignant au besoin la fiction, tâche qui reviendra à la troisième voix anonyme.
❝Simone elle est partie avec tout un tas de choses qu’on ne saura jamais — et puis après quoi ? — on ne fait que parler de tout ça — on raconte — on invente — on brode — et ça suffit à faire des histoires de famille non ?❞
Le carton s’ouvre sur des fantômes et un passé qui reste à écrire, une histoire familiale à élucider en restituant la présence d’êtres dont la trace aurait pu disparaître. Il y a là une mémoire à réveiller, une réalité à densifier et, nous le comprendrons plus loin, un territoire inconnu à réinvestir par les mots.
La rencontre romantique sur les bords du lac de Constance, le mariage de Simone et Paul, l’enfant qui s’annonce alors que Sanzach doit bientôt embarquer à bord du Pasteur ;
❝La première traversée de Marseille au cap Saint-Jacques, celle de l’enthousiasme et des allures de croisière où les hommes embarqués, bien que trimballés en hamac et comprimés sous les airs chauds, partaient l’esprit enduit d’aventure et d’inconscience vers l’Indochine qui sonnait exotique et brûlante, belle à la tombée de la nuit — et, il faut bien le dire, pas si dangereuse que ça.❞
l’arrivée, l’installation dans un pays loin d’avoir la beauté promise de l’ailleurs, la désillusion ;
❝[…] l’Indochine apparaissait toujours un peu plus vaseuse que la veille, toujours plus vaste et imprenable, collante aux bottes, sans parler de la pluie, agressive et sans fin, de l’eau brune qui suit la mousson et inonde les chemins, brouille les pistes, efface les traces, nivelle tout, empêche de voir plus loin que le bout du fusil. Nombreux étaient les hommes qui en avaient plein le cul de ce coin de terre hostile, alors rien de mieux que de parier sur les femmes, sur les capacités des uns et des autres à se taper celle-ci ou une autre.❞
les lettres quasiment quotidiennes et puis, celles de Sanzach de plus en plus rares, de plus en plus factuelles, sans grand intérêt, fuyantes même, laissant sans réponse les questions pressantes de Simone — la distance entre eux deux n’étant plus uniquement géographique ;
❝[…] c’est bien un jeu de dupe qui s’installe entre les mots qu’ils s’envoient tous les jours, un étrange écart qu’ils entretiennent l’un et l’autre. Ils se mentent. Ils ne se disent pas les choses. Ils font semblant de se croire. Simone ne dit pas tout. Et Paul Sanzach encore moins.❞
l’énigmatique Tilleul, celui qui allait être le témoin de ce qui macérait dans la touffeur collante d’Indochine, entre les murs de nattes et de chaume gorgés des eaux de la mousson, celui qui allait tout voir mais ne dirait rien.
❝Ce gosse s’appelait Tilleul et Simone chercha son regard, un instant, ne sachant pas qu’elle scrutait le regard de celui qui allait tout voir.❞
Tout cela parle d’un passé que le Je narrateur n’a pas connu, d’un pays qu’il ne sait pas mais dont quelques échos se tissent à l’instant présent (deux exemples parmi tant d’autres — la pluie lave l‘avenue d‘Italie comme elle noyait la jungle, jungle dont l’appartement voisin de monsieur Trān, envahi d’un fouillis de plantes, reproduit la luxuriance ; le cliquetis des armes que les hommes trimballent dans les profondeurs de la jungle rappelle à l’oreille le tic-tac des horloges du père de Simone). Ainsi le Je œuvre-t-il avec les restes d’un passé qui ne cesse de revenir, sous d’autres formes, dans son présent.
L’écriture d’Adrien Genoudet est riche d’heureuses trouvailles qui réveillent la langue en faisant naître l’imprévisible. Par moments, j’ai pensé à Pierre Michon, non pour le rythme quasi liturgique de son écriture bien sûr, mais pour sa manière d’entrer dans la langue avec cette impression qu’un mot y rencontre un autre pour la première fois pour mêler le factuel au subjectif, le subjectif au métaphorique :
❝Sanzach lui fit face, les dents serrées, la voix désertique. […] Le silence était épais, brutal ; personne ne mouftait. Sanzach fit volte-face, laissant la chair de Tilleul reprendre ses contours, sa chaise et sa bière vide. En se rasseyant parmi les autres, silencieux comme des noix, il se mordit l’intérieur, l’œil morne, et il entendit la chute d’un arbre, l’écorce qui cède sous le poids du tronc. Sanzach goûtait quant à lui l’écrasement du silence.❞
et
❝Brunet laissait ensuite planer un silence violent dans lequel il semait quelques quintes de toux, une pression appuyée de sa domination tout autour, une toux comme une ponctuation.❞
ou
❝[…] en la revoyant assise sur sa chaise pliante sur le perron, le corps vieux et les yeux mangés par l’éclipse, je me dis qu’elle est autant la fille d’un drame personnel que celui, plus grand, injuste et terrible, des Pénélope — des femmes qui sont au monde pour attendre le retour des hommes.❞
ou bien encore
❝Je me suis mis à compter les cernes […] Quatre-vingt-douze. Le tilleul avait quatre-vingt-douze ans l’année de sa coupe. Et je n’ai pu m’empêcher, du fait des interférences et des petits tremblements des noms propres, de me dire que Tilleul, s’il était encore en vie […] devait avoir, à peu près, cet âge.❞
La façon de jouer avec l’usage commun de la langue et la multiplicité des angles narratifs contribuent à faire de Nancy-Saïgon un récit autant esthétique que puissamment immersif. Nous nous mouvons dans l’espace et le temps avec la sensation d’être à la fois bloqués dans l’appartement parisien, avec Simone et Paul au bord du lac de Constance, avec Simone et la petite Édithe au domicile nancéien, avec Paul et Tilleul à bord du Pasteur quand il rallie enfin le Cap Saint-Jacques depuis Marseille après des semaines en mer, et pour finir avec les hommes en Indochine, sa jungle inextricable et hostile, ses bars interlopes aux vapeurs d’alcool frelaté, de fornications bestiales et d’opium bon marché. Nous sommes là, convaincus d’appréhender l’histoire dans ce qu’elle a de plus fondamental, dans sa complexité à défaut de son intégralité, alors que l’auteur, dernier destinataire, confiné et empêché, libère les archives familiales du carton pour les faire vivre dans ce roman qui hésite brillamment entre plusieurs genres littéraires et choisit de ne pas choisir.
❦
Roman lu dans le cadre de la Masse Critique privilégiée Littératures de Babelio en partenariat avec les éditions du Seuil que je remercie.
꧁ Illustration ⩫ Baie des cocotiers et Cap Saint-Jacques, Cochinchine, début XXe siècle ꧂
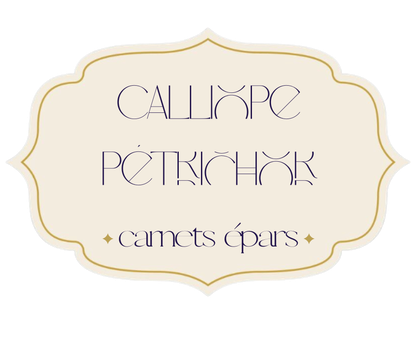



Écrire commentaire