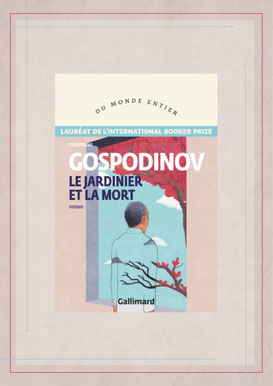
❝— Vieillard, tu te connais aux travaux du jardin ; quelle tenue ! quels arbres ! vigne, figuiers, poiriers, oliviers et légumes, tu ne négliges rien…, du moins en ton verger, car — laisse-moi te dire et ne te fâche pas —, sur toi, c’est autre chose !❞
Homère, L’Odyssée, chant XXIV, Les Belles Lettres, 2001, traduction de Victor Bérard
❦
❝Mon père était jardinier. À présent c’est un jardin.❞
L’équilibre parfait des deux heptasyllabes de l’incipit donnent la structure même du dernier roman du bulgare Guéorgui Gospodinov, dont on croirait le titre tout droit sorti d’un recueil de fables.
❝J’aimerais qu’il y ait de la lumière, une lumière d’après-midi, douce, dans ces pages. Ce n’est pas un livre sur la mort, mais sur la tristesse de voir la vie qui s’en va. C’est différent.❞
Ni linéaire ni chronologique, mais fait de retours et détours, Le Jardinier et la mort est un récit à forte tonalité autobiographique bien que l’auteur, dont le père est mort récemment, prévienne dès son seuil :
❝Toute histoire, même réalisée et personnelle, une fois passée par la langue, revêtue de mots, ne nous appartient plus, elle est désormais de l’ordre autant de la fiction que de la réalité.❞
En quatre-vingt-onze chapitres de deux trois pages au plus chacun, Guéorgui Gospodinov raconte dans la première partie, la mort qui rôde et va emporter le père et, dans la seconde, le temps d’après.
À bien des égards, le narrateur, en documentant au jour le jour l’avancée de l’inéluctable, tente de donner chair au moment où il s’efface à un père fait de silences. Sa façon à lui de déclarer son amour à cet homme qui savait si bien cacher le sien à cause de cette ❝bêtise patriarcale balkanique❞, qui veut que l’on s’interdise d’être trop démonstratif et que l’on résiste à tout, y compris aux preuves d’amour.
Pour ce père qui avait eu le don de transformer chaque maison en un foyer, ❝le jardin était son autre vie possible, sa voix et tout ce qu‘il taisait. C‘est par lui qu‘il parlait.❞
Et le jardin du père, aussi modeste soit-il, apparaît comme la représentation même de cette résistance obstinée :
❝Mon père cultivait comme on prie – non pour repousser la mort, mais pour l’apprivoiser.❞
Le récit est un maillage d’anecdotes et de souvenirs tissés au moment présent, non pour suspendre voire abolir le passage terrible du temps, mais pour l’accompagner en se remémorant l’enfance ; la vie sous le communisme de l’Europe de l’Est, qui a muré des générations entières dans le mensonge, le silence et la peur ; l’exiguïté des appartements sombres en souplex avant la montée vers la lumière des étages supérieurs ; la maison enfin et son jardin, simple et utile, qui l’avait apaisé et sauvé d’un premier cancer dix-sept ans plus tôt. Il en va différemment à présent ; la douleur aux reins n’était pas une banale courbature due aux travaux du jardin, elle a révélé une invasion métastasique et il est malheureusement certain que le miracle de la guérison n’aura pas lieu une seconde fois. Si revoir le printemps et écouter chanter les coucous en avril sont exclus, ❝Noël c’est possible❞ a concédé le médecin.
Guéorgui Gospodinov évoque la mort prochaine du père ; les journées lentes, longues et lourdes de douleurs insupportables ; les nuits de veille inquiète ; les traitements qui apaisent si peu et si mal ; les gestes qui soignent un corps en souffrance et se substituent aux mots quand ils se dérobent ; le père redevenant l’enfant. Tout est écrit avec une simplicité et une tendresse qui forcent le respect alors même que le narrateur, s’aventurant aux limites du dicible, ne cache rien de ce que la maladie vole à la dignité humaine. Ces jours passés auprès de son père sont une manière de le rencontrer autrement. L’humour des histoires qu’il continue de raconter,
❝Les histoires plaisantes sont nécessaires dans les situations pressantes.❞
comme les expressions qui n’appartiennent qu’à lui éloignent tout apitoiement sordide.
❝Tran-qui-lle-rie : un mot si tranquille qu’il vibre légèrement. Généralement, on le sent au coucher du soleil, à la tombée du soir, lorsque même le silence est translucide et que les oiseaux cessent un instant de chanter.❞
La maladie est l’occasion de revisiter le passé, d’interroger longuement la mémoire avant qu’elle ne s’en aille avec lui.
❝Cette histoire familiale non écrite n’existe plus. Je sais qu’avec la mort de mon père, ce n’est pas un monde qui disparaît, mais plusieurs qui s’en sont allés.❞
La mort s’invite à quatre jours de Noël, aux petites heures du matin ; le père meurt au jour naissant. Nous voilà rendus presque au milieu du roman dont la seconde partie s’attache à dire le temps d’après, celui de la douleur immense et de la tristesse. Le temps des premières fois sans lui.
❝Jardinage et mort. Je crois que nous pouvons considérer le jardinage comme orienté par principe contre la mort. Au jardin, on enterre continuellement quelque chose et l’on attend qu’au bout d’un certain temps le miracle se produise et que cette chose germe différente, de la grainé qu’on a semée.❞
Le jardin est un lieu autant de vie prolifère que de mort passagère, les cycles s’y accomplissent immuables, et le temps passe. Si le motif jardin est l’une des métaphores habituelles de l’existence, l’écriture — à la main — pour le narrateur est un moyen de prendre le temps, de négocier un peu plus de temps avec le disparu. Ce n’est qu’après la mort du père qu’il s’autorise à le raconter. Ce colosse de près de deux mètres était né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une Bulgarie alors sous la coupe de l’Union soviétique ; il mettait un entêtement risible à éviter les célébrations du coup d’État du 9 septembre 1944 ; ses prises de position, les mots qu’il ne mâchait pas, tout cela lui avait valu de perdre son emploi ; son allure hippie, ses cheveux longs et sa moustache, l’avaient conduit d’autorité chez le barbier afin qu’il y mît bon ordre.
Et ce jardin dont l’abondance disait son amour aux siens.
❝Et c’est alors que je l’ai découvert, non pas qu’il l’ait caché, mais c’était la première fois que je l’ouvrais. Le carnet de mon père. Son unique journal, tenu durant ses dernières années. Parler de son journal est trompeur, vous n’y trouverez rien de personnel, mais tels sont les journaux intimes bulgares.
[...]
Il n’existe pas de forte tradition de journaux intimes, romans épistolaires, etc., au siècle dernier ni durant les siècles précédents, dans la vie bulgare. Et cela fait partie de notre mutisme atavique à l’égard de l’intime.❞
Trouvé après sa mort, le petit carnet noir dans lequel le père consignait les menus travaux du jardin,
❝Chaque printemps, les oignons plantés, les arbres greffés, la pluie comptée en jours, des récoltes fragiles. Comme si le monde pouvait se sauver en restant fidèle au cycle des saisons.❞
est une sorte d’almanach très personnel où le jardinier notait le cycle de la vie sans cesse recommencé alors que le fils, lui, écrit pour continuer à faire vivre le père malgré l’abîme dans lequel sa mort l’a précipité.
❝Mon père nous a laissé ces dernières paroles malgré tout […] nous les lirons au printemps.❞
En associant son défunt père au jardin, le narrateur le fond à tout jamais dans les confins tranquilles du paysage autour de la maison, là où la mort toute-puissante ne peut étendre sa prise.
Choisir l’écriture comme manière salvatrice de dire l’absence, ce qui aurait pu être mais ne sera pas, n’est pas follement original, mais le narrateur dit ici avec une émotion aussi poignante que mesurée ce qu’il a éprouvé aux temps d’avant le deuil, du deuil et de l’après. Le père a beau n’être plus là, il n’a jamais été aussi présent que dans ces pages. Guéorgui Gospodinov écrit magnifiquement (grand merci à Marie Nivrat-Nikolov pour sa traduction impeccable nous donnant l’impression que le roman a été directement écrit en français) la tension entre la perte irréversible et la permanence de la mémoire. C’est par le jardin qu’une continuité s’instaure et que le lien avec le défunt subsiste. Une relation inédite dans laquelle père et fils sont séparés, mais à jamais inséparables. À ceux qui redouteraient de lire un livre déprimant sur le deuil, je dirai, empruntant les mots au père :❝Rien d’effrayant.❞
❦
꧁ Illustration ⩫ Paul Cezanne, Le Jardinier, c. 1885 ꧂
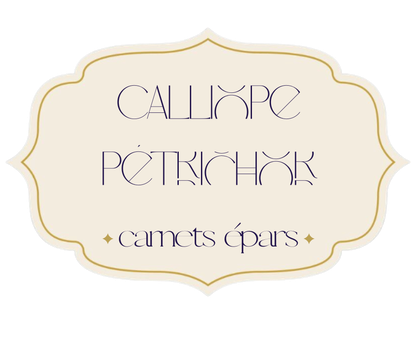



Écrire commentaire