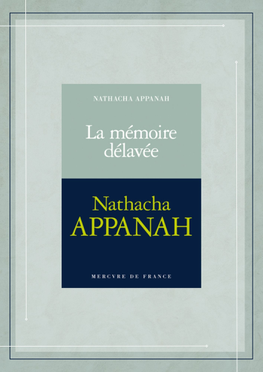
La Mémoire délavée
Nathacha Appanah
Mercure de France, Coll. Traits & Portraits
160 pages
31/08/2023
17,50 €
❝La mémoire est dans le cœur.❞
Madame de Sévigné, Lettres
❦
❝Je ne veux pas simplement raconter mes grands-parents, je veux dépasser le récit, je veux une harmonie, de la complexité à l'envers mais de la simplicité à l'endroit. Je rêve d'un livre qui dirait le passé, le présent et tout ce qu'il y a entre.❞
La Mémoire délavée de Nathacha Appanah vient de paraître au Mercure de France dans la collection Traits et Portraits fondée par Colette Fellous il y a bientôt vingt ans. Cette collection de beaux livres accueille des textes de commande à caractère autobiographique ainsi que du matériau iconographique souvent tiré des archives de l’auteur.
Avec cette commande l’occasion est donnée à Nathacha Appanah d’initier le lent mouvement de réveil mémoriel symbolisé par le vol des étourneaux dans le ciel du soir, qui ouvre son récit. Ces oiseaux empruntent chaque année un même couloir migratoire et, ce faisant, se livrent à un ballet fascinant où se dessinent, s’effacent, se recomposent, se désagrègent des formes éphémères alors que l’obscurité s’avance.
La Mémoire délavée est la tentative de la petite-fille de reconstituer la trajectoire symbolique et matérielle de sa famille dont les trisaïeux ont quitté en 1872 l’Andhra Pradesh, état très pauvre du sud-est de l’Inde, pour remplacer les esclaves noirs dans les plantations de canne à sucre de l’île Maurice, ❝cette île bleue par-delà l'eau noire❞. L’esclavage, aboli le 1er février 1835 sur l’île, a ouvert la voie à l’immigration indienne qui durera 90 ans et fournira une main-d’œuvre alternative.
❝Une île produit soit des dieux, soit des esclaves.❞
José Carlos Llop, La Ville d'ambre
Ces exilés volontaires à qui on avait fait miroiter bien des choses dont un contrat limité à cinq ans s’appelaient engagés en français ou coolies en anglais. Après plus de sept semaines en mer, au moment de débarquer, la désillusion le disputait à l’accablement et à la certitude prégnante de ne jamais plus revoir le pays natal. Ils n’étaient plus qu’un numéro dans un registre et s’éreintaient dans des plantations sans avoir la moindre idée de quand cela prendrait fin.
❝Il y a aussi, à l’époque de la plantation, un quotidien si lourd que le temps pour cette mémoire écrite, pour cette mémoire attestée et vérifiée, n’existe pas. À quoi bon savoir exactement sa date de naissance quand la cloche du domaine sucrier sonne tous les jours à 5 heures du matin et qu’il faut faire son quota quotidien ? À quoi sert se rappeler l’orthographe exacte de son nom quand les corps et les esprits sont occupés à survivre et que toute sa vie est circonscrite par la plantation ? Comment imaginer un seul instant, dans ces années où même les enfants travaillent, où l’instruction n’est pas accessible encore, où la mort est fréquente, comment imaginer un seul instant que sa présence sur terre est digne d’être inscrite noir sur blanc ? Comment croire qu’on peut être un souvenir précieux, une mémoire à transmettre ?❞
En situation de déplacement comme c’est le cas pour la famille de Nathacha Appanah, la mémoire familiale est consubstantielle à la mémoire migratoire. Cependant que l’histoire migratoire des (tri)aïeux est rarement racontée, encore plus rarement écrite, pour être transmise aux générations futures sous la forme d’un récit qui s’annoncerait comme tel, les descendants doivent opérer une reconstitution minutieuse pour colmater les brèches tout en essayant de trouver une temporalité linéaire et un enchaînement logique à partir de bribes de souvenirs et, quand ceux-là viennent à manquer, de documents d’archive. Le récit de Nathacha Appanah suit la chronologie de 1872 à nos jours, de l’Inde à l’île Maurice à la France.
❝Dans ma famille, […] jamais le nom de mes ancêtres n’a été prononcé à voix haute, leurs photos et leurs numéros honorés. Nous devions respecter les coutumes et les traditions de notre communauté mais pas forcément connaître ceux qui nous les avaient léguées. Alors de ces engagés-là, on sait peu de choses, on croit savoir, on dit : peut-être, probablement, il semble que, c’est vieux, tout ça, c’est fini ces choses-là. Alors, pendant des années, j’ai cru et aimé croire que mes ancêtres avaient quitté l’Inde au début du XXe siècle et étaient arrivés en famille. Mon esprit les a lavés, ces ancêtres, essuyé leurs visages, coiffé leurs chevaux, habillés de vêtements propres, éloignés des cales de bateaux et de la perspective du labeur quotidien des champs de canne. C’est une image presque proprette. C’est une mémoire délavée.❞
Dans la famille de Nathacha Appanah, la transmission est inscrite dans les gestes, coutumes, superstitions que ses grands-parents tenaient des anciens et continuaient de pratiquer, invitant le passé à circuler comme par capillarité dans le présent. Le portrait qu’elle fait d’eux, émouvant et respectueux, occupe la plus grande partie du récit. En ce sens, La Mémoire délavée est l’histoire de leur vie, eux petits-enfants d’engagés, le compte-rendu de l’écart générationnel et culturel qui se creuse avec leur petite-fille, de l’écart géographique entre les jours passés à la maison de Piton et la vie en France.
❝Et moi, j’ai vécu avec mes grands-parents pendant les dix premières années de ma vie, dans leur maison. Ils représentaient un monde complètement disparu. Ça n’existait plus. Moi, j’allais à l’école, mes parents étaient allés à l’école. J’apprenais des langues. Eux, ils n’en parlaient qu’une. Ils ne savaient ni lire ni écrire et j’évoluais comme ça sur une ligne, comme une ligne d’acrobate, entre un monde perdu et un monde moderne.❞
Il est clair bien sûr que parler d’eux par le biais de ce récit qu’elle veut ancrer dans le réel documentaire est une manière oblique de parler d’elle. En retraçant la trajectoire de sa famille, en repigmentant les zones délavées de la mémoire, Nathacha Appanah redessine sa généalogie et y trouve son identité.
Des photographies issues de la collection personnelle de l’autrice, des images d’archives, des gravures anciennes ponctuent le récit. Parfois décalées, sans lien apparent avec ce qui est écrit, elles offrent une double perception, une autre transmission du réel, elles sont une manière de preuve testimoniale — le temps qui passe, la mémoire pour éternité. Le récit est augmenté par l’image, le temps du récit est augmenté de l’espace de la photographie.
❝La mémoire, comme le rêve, dilue les couleurs, la mémoire est comme une photographie exposée au soleil.❞
José Carlos Llop
L’écriture de Nathacha Appanah est à l’image de ses grands-parents : le grand-père calme et réservé ; la grand-mère superstitieuse et sensible, petite par la taille mais grande par le caractère. J’ajouterai que cette écriture est généreuse tout en restant pudique et, ici particulièrement, d’une tessiture singulière, à la fois fragile et profonde, habile à remuer le lecteur quelle que soit sa propre histoire.
❝Il faut enlever le vernis sur chaque page, éplucher cette peau-apparat sous laquelle le récit est nu, le récit est sincère, le langage est celui de l'eau, de la terre, de la nuit.❞
Écrire est une manière d’éviter de tout perdre en retenant ce qui peut l’être encore. Quand elle révèle la part d’histoire familiale qui avait été placée sous l’éteignoir, Nathacha Appanah rend hommage aux siens, et de la plus belle manière qui soit, celle qu’elle dit avoir rêvée. La Mémoire délavée est le versant autobiographique de son premier roman paru en 2003, Les rochers de Poudre d'Or. Un bonheur de lecture et d'humanité.
❦



Écrire commentaire